Appel à communication
La fiction posthumaniste
- Projections, représentations et critiques du Transhumanisme -
Colloque organisé dans le cadre du projet « Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaires » géré par l’Observatoire des écritures françaises et francophones contemporaines (CSLF), Université Paris-Nanterre.
Organisateurs :
Mara Magda Maftei,
Professeur à l’Université d’Études Economiques de Bucarest, membre associée de l’Observatoire des écritures contemporaines, Université Paris Nanterre.
Emmanuel Picavet,
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cotitulaire de la Chaire Éthique et Finance, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
Dominique Viart, Professeur à l’Université Paris-Nanterre, directeur de l’Observatoire des écritures contemporaines, membre de l’Institut Universitaire de France.
 Présentation
Présentation
Le transhumanisme nomme les ambitions scientifiques qui projettent de délivrer l’Homme de ses contingences biologiques et de le rendre plus performant dans tous les domaines, physiques ou mentaux. Les récents progrès de la médecine, de la transplantation et de l’implantation, de la robotisation et de l’intelligence artificielle montrent qu’il ne s’agit plus d’utopie ni de science-fiction, mais de réalité en partie tangible, avérée, en plein développement.
De telles mutations soulèvent bien des questions : politiques, économiques, sociales, philosophiques (notamment morales et relatives aux modèles de société), technologiques… dont tente de se saisir la pensée posthumaniste. Littérature, philosophie, anthropologie, sociologie, réflexions éthique et politique ne restent pas indifférentes : la finalité de tels programmes vise-t-elle la création d’un « ultra-humain » (Teilhard de Chardin), d’un « néo-humain » (Michel Houellebecq), d’un « surhumain » (Jean Rostand), d’un « sous-homme » (Henri Lefebvre), d’un « surhomme » (Nietzsche), d’un « trans-humain »? A-t-on devant nous la fin de l’humanisme, selon des modalités qui prennent le relais des diagnostics concernant sa perte de sens ou son dépassement chez des penseurs sceptiques structuralistes, poststructuralistes ou postmodernes ? Ou signifie-telle la fin de l’Humain tel qu’anthropologie et biologie nous ont appris à le concevoir ?
Forme critique de la pensée, le posthumanisme s’exprime diversement en philosophie, en littérature, dans les essais de prospective, les œuvres cinématographiques et autres formes d’art. On a voulu distinguer le posthumanisme technoscientifique qui porte aux nues la Raison et le Progrès du posthumanisme philosophique et culturel, plus littéraire ou artistique, qui se constitue volontiers en critique du progrès et de ses conséquences néfastes sur l’humanité.
La littérature posthumaniste française compte déjà aujourd’hui une trentaine de romans. Elle se dote d’un langage scientifique et technique approprié aux transformations auxquelles nous assistons aujourd’hui. Ses auteurs explorent un certain nombre d’obsessions : société de contrôle, eugénisme, réseau, fabrication d’un nouvel « homme nouveau », modifications biologiques et génétiques, déconstruction de la subjectivité, asexualité, technologies de surveillance, totalitarisme numérique…
Ils fictionnalisent des personnages réels comme Norbert Wiener (Pierre Ducrozet, L’Invention des corps, 2017), Nick Bostrom (Rémi Gageac, Life ++. La Vie augmentée, 2015) ou Ray Kuzweil (Gabrile Naëj, Ce matin maman a été téléchargée, 2019, Marc Dugain, Transparence, 2019, François-Régis de Guenyveau, Un dissident, 2019), mettent en scène des robots et des programmes informatiques (Isabelle Jarry, Magique aujourd’hui, 2009 ; Antoine Bello, Ada, 2016 ; Alexis Brocas, Un Dieu dans la machine, 2018…) et montrent comment, favorisé par le néolibéralisme dont il exacerbe les ambitions, le transhumanisme assujettit l’individu à l’Intelligence Artificielle, et lui demande d’être performant et compétitif sur le marché de travail (Camille Espedite, Cosmétique du chaos, 2020).
En prise directe sur un réel en devenir, ce champ littéraire partage certes des caractéristiques communes avec la science-fiction et avec les dystopies, mais s’autonomise dans une forme nouvelle nourrie d’interdisciplinarité au sein de laquelle des variantes se dessinent : les unes plus concentrées sur la critique de la société contemporaine, les autres dans la spéculation d’une réalité donnée.
Le colloque s’intéressera à ces deux formes présumées de posthumanisme, au contexte dans lequel l’idéologie transhumaniste est née, à son impact possible sur la vie économique et sociale. Il étudiera comment la littérature et les autres formes d’art produisent les représentations critiques de telles élaborations de la science et de la technique.
Il s’adresse aux chercheurs en Littérature, Philosophie, Sciences humaines et aux écrivains français concernés par ces questions. Des industriels seront invités à témoigner sur l’apport des nouvelles technologies et leurs conséquences sur l’organisation du travail en entreprise : robotisation, exosquelette, drone, Intelligence Artificielle, NTIC, etc.
 Modalité de soumission
Modalité de soumission
Les propositions de communication, comprenant un titre, un résumé d’environ 300 mots ainsi que 5 mots-clés et une bibliographie d’environ 5 titres, sont à adresser dès maintenant et dernier délai au 15 octobre 2020 à :
Mara Magda Maftei : mmmaftei@parisnanterre.fr
Emmanuel Picavet : emmanuel.picavet@univ-paris1.fr
Dominique Viart : dominique.viart@parisnanterre.fr













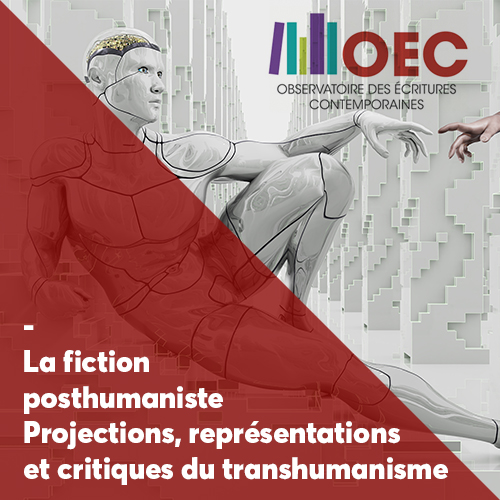
 Présentation
Présentation