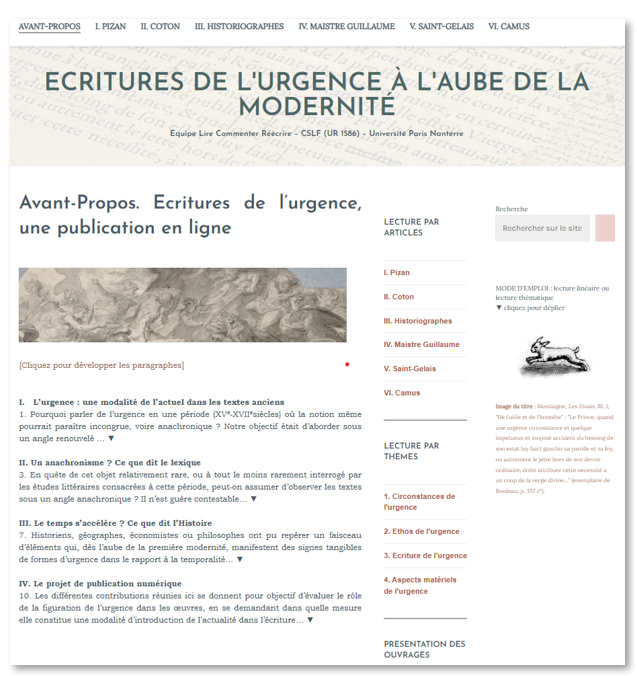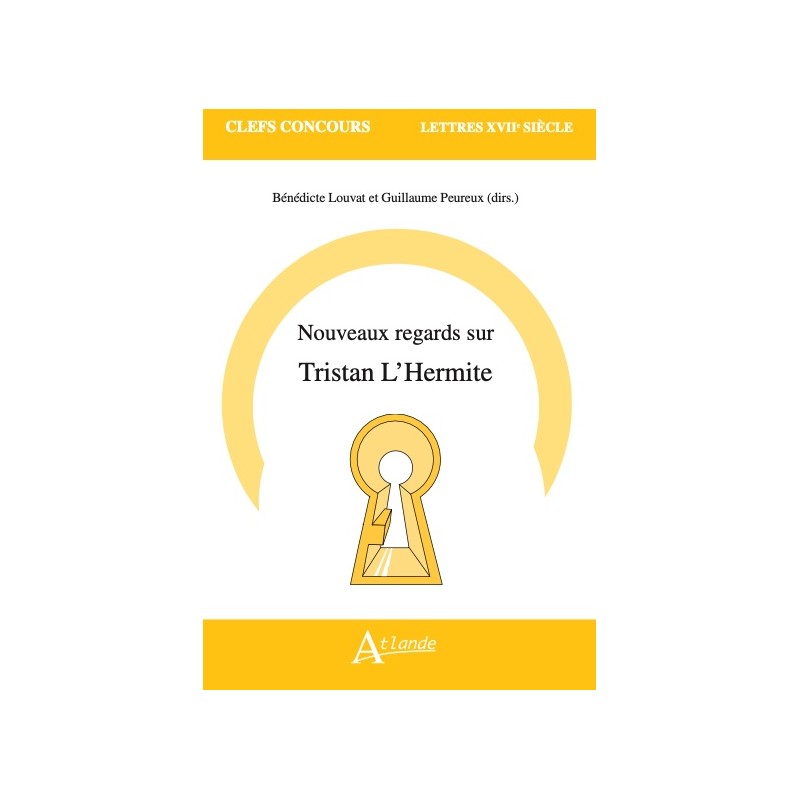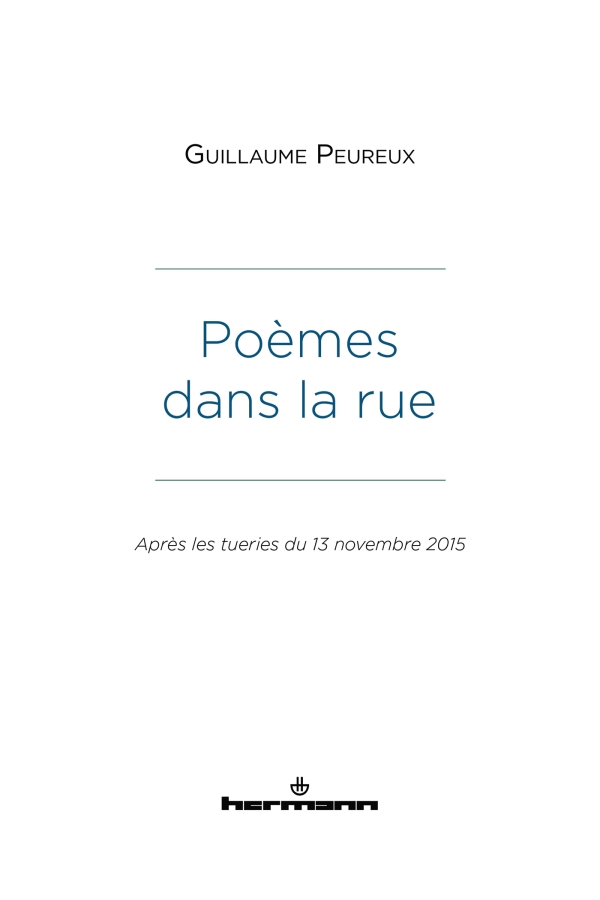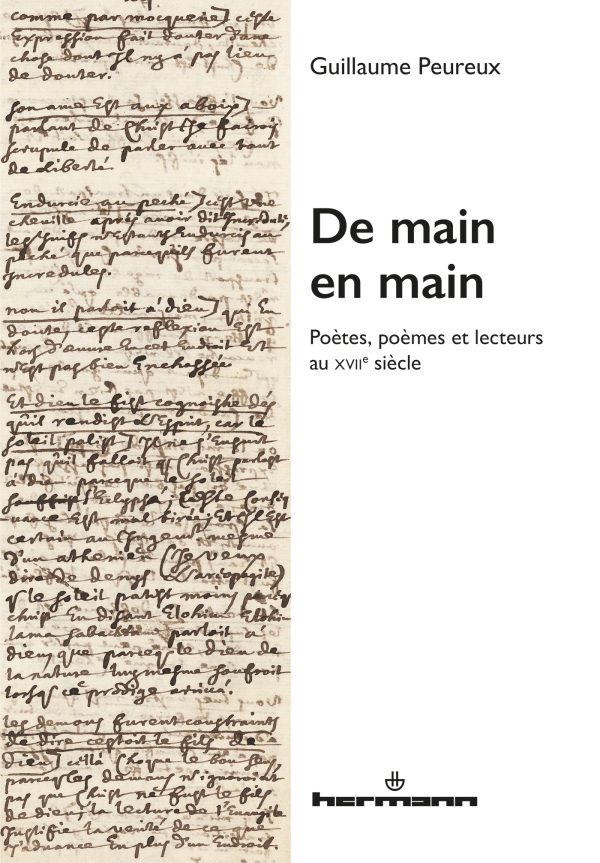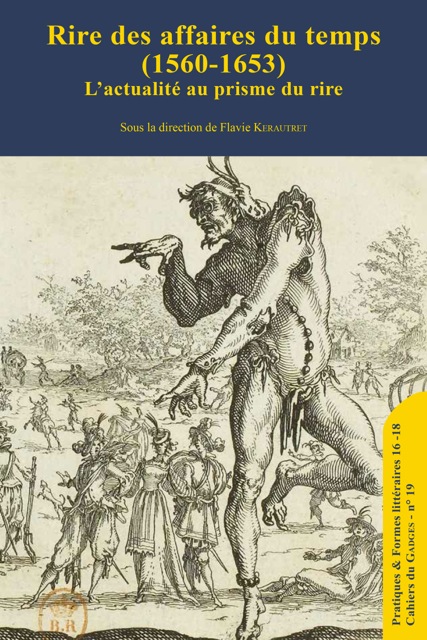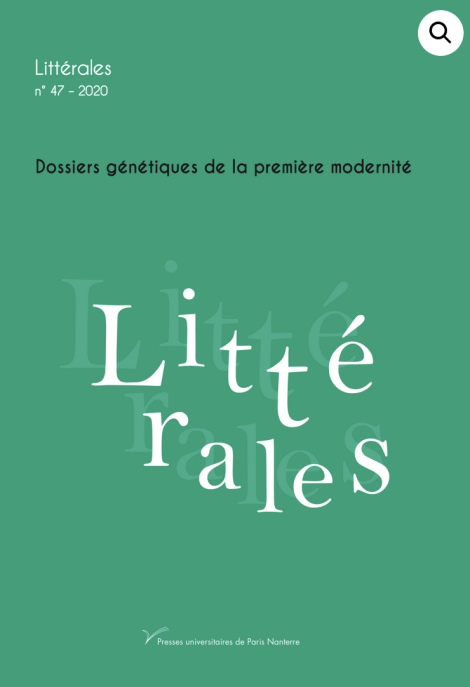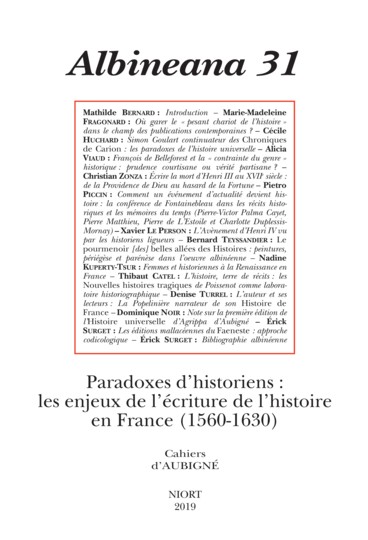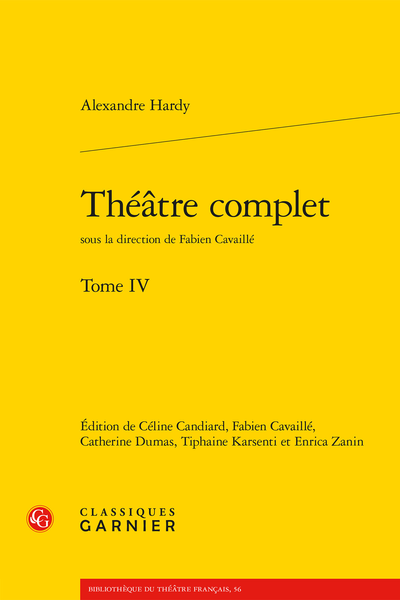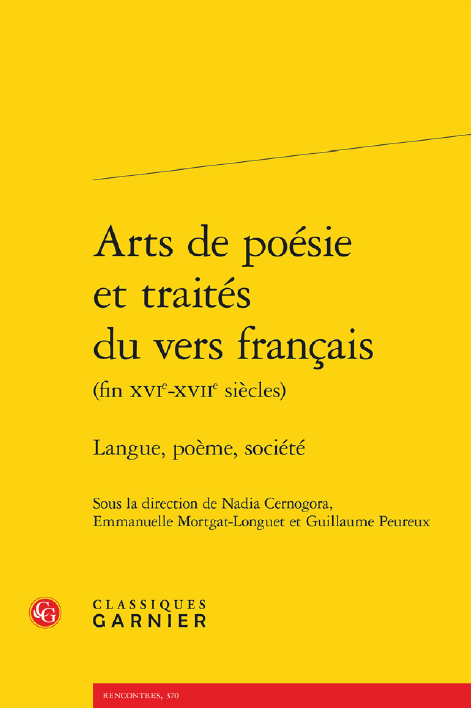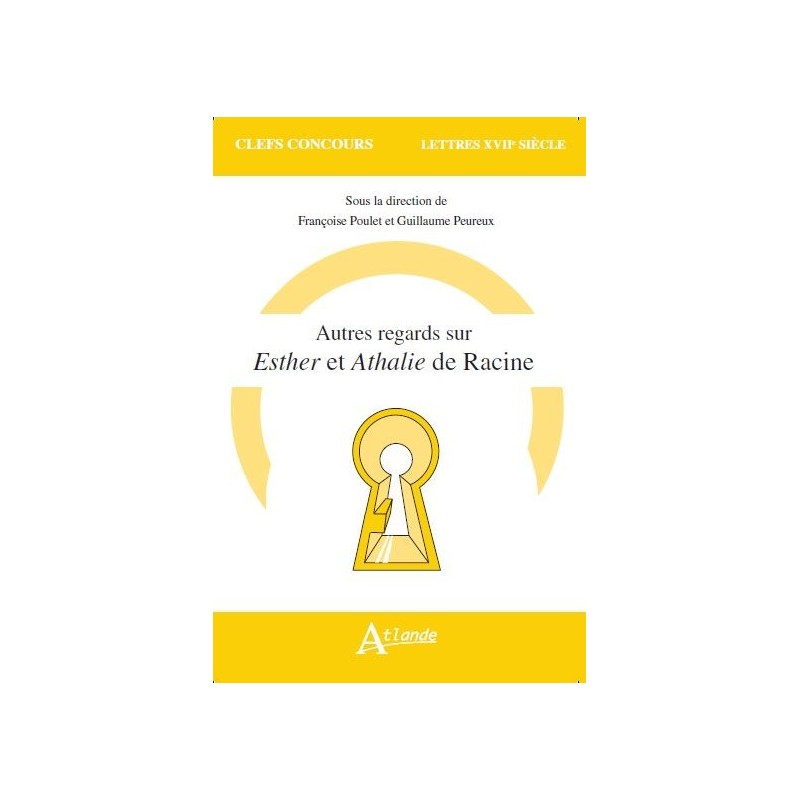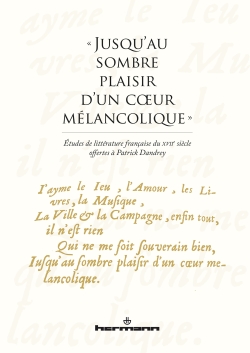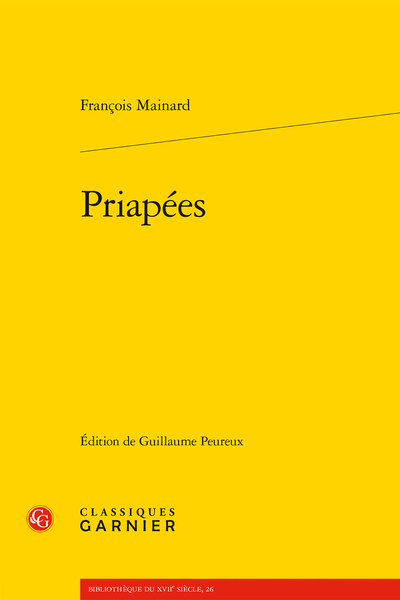Version française / RECHERCHES
Lire, Commenter, Réécrire
- séminaire
-
Responsables : Mathieu de La Gorce et Sylvie Robic, avec Guillaume Peureux
Les recherches engagées par l’équipe LCR suivent pour fil directeur la question de la représentation, ou des traces de l’actualité dans les textes de la première modernité. Après un programme consacré à la pratique des commentaires contemporains, puis un programme traitant des enjeux liés à l’urgence dans cette période, le programme débuté en septembre 2023 a pour objet de questionnement la figuration des personnes en position de subordination, en particulier dans le cadre d’une domination sociale, dans les textes du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Ce projet fait écho à la volonté constante qui anime l’équipe d’envisager les phénomènes d’écriture dans la première modernité à rebours d’une lecture figeant leur production dans un caractère intemporel ; il rejoint le choix de se centrer sur la part circonstancielle et liée à l’actualité des faits littéraires, mais en prenant cette fois en compte une dimension plus politique et sociale de ces circonstances. Tout en conservant un esprit similaire et une même volonté de travailler en commun, le projet réoriente donc la perspective qui était la nôtre jusqu’à lors ; il résonne avec les ambitions du CSLF d’intégrer les apports des sciences humaines à ses recherches pour renouveler les approches de la littérature des siècles anciens. La tradition de l’Histoire saisie « from below » selon l’expression de E. P. Thompson, et qui s’est accompagnée d’un essor des subaltern studies, constitue un point d’ancrage méthodologique à partir duquel penser ou repenser une manière d’observer et d’analyser d’un point de vue littéraire ces types de représentations, les imaginaires qui y sont associés et les enjeux qui s’y attachent dans les productions écrites de la première modernité.
Si l’intérêt majeur n’est probablement plus de défaire des stéréotypes qui reposent sur les biais des traitements historique comme historiographique, ces derniers ayant déjà été très largement étudiés et commentés par les historiens, il demeure cependant que les études proprement littéraires qui se sont penchées sur ces figures pour les siècles anciens ne sont pas si nombreuses. On pense ainsi réfléchir à ces profils liés à la marginalité ou à toute forme d’infériorité, non pour en dresser une histoire, mais pour tenter d’appréhender des modalités de leur présence en littérature, les traces qu’ils y ont laissées, le sens qu’il faut accorder à la distance focale avec laquelle ils sont représentés, au premier ou à l’arrière-plan, ou même leur absence et les raisons potentielles de cet effacement.
En confrontant leurs objets d’étude, ils et elles voudraient étudier les formes que prennent ces liens de subordination dans la littérature de la première modernité : peut-on percevoir des formes d’homogénéité de ces profils, ou encore des schémas d’évolution de leurs représentations ? Des liens complexes entre pouvoir et savoir, pouvoir et écriture, gouvernent les représentations et guident les imaginaires : de telles figures mineures peuvent-elles émerger et faire entendre leurs voix dans la production écrite ? De quelle façon et comment ont-elles été perçues alors et comment le sont-elles aujourd’hui ? À quels stéréotypes ou à quels types d’imaginaires obéissent-elles ? De tels stéréotypes assignent-ils à ces figures une place qui conforte le modèle de domination ? Y a-t-il des voies littéraires pour s’en affranchir ? - membres
-
Responsables : Mathieu de La Gorce, Sylvie Robic, avec Guillaume Peureux
Enseignant.e.s-chercheur.se.s
Mathilde BERNARD (MCF)
Carole BOIDIN (MCF)
Hélène BOONS (MCF)
Mathieu DE LA GORCE (MCF)
Emmanuelle MORTGAT (MCF)
Guillaume PEUREUX (PR)
Liliane PICCIOLA (PR émérite)
Florence POIRSON (MCF honoraire)
Sylvie ROBIC (MCF)
Florence TANNIOU (MCF)
Clotilde THOURET (PR)
Membres associé.e.s
Therese BANKS (Middlebury College)
Flavie KERAUTRET (Université Sorbonne Paris Nord)
Nadine KUPERTY-TSUR (université de Tel Aviv)
Doctorant.e.s
Issar Ben SIDHOUM, Le roman à l’épreuve du burlesque : autour de Scarron, Cyrano et Furetière, dir. Guillaume Peureux
Thomas BARRIERE, Scènes de bêtes. Représenter l'animalité dans les arts du spectacle aux XVIe et XVIIe siècles (Italie, France, Espagne, Angleterre), dir Clotilde Thouret
Sui CHOI, Publications et usages des contes de Perrault du XVIIe siècle à aujourd’hui, dir. Guillaume Peureux
Stella DOUKHAN, Poésie et poétique de la mort tragique à l'Âge classique, dir. Guillaume Peureux
Pauline FABIANI, La poésie pétrarquiste revisitée de Desportes à Malherbe (1572-1630), dir. Guillaume Peureux
Thomas PANDELLE, La première épopée du Brésil : édition, traduction et commentaire du De Gestis Mendi de Saa, de José de Anchieta (dir. Jean-Claude Laborie)
Aliou SI, Édition critique des oeuvres d’Adam Billaut (1602-1662), dir. Guillaume Peureux
Xiaohua ZHAO, La Fayette au cinéma : exhumation et invention, dir. Guillaume Peureux - Publications
-
- Ecritures de l'urgence à l'aube de la modernitéPublications CSLF de l'IR Huma-Num, 2025 Lire la suite
- Nouveaux regards sur Tristan l’Hermite de Bénédicte Louvat et Guillaume Peureux (dir.)Neuilly, Atlande, 2023Traitant de l’œuvre du XVIIe siècle au programme des agrégations externes de Lettres classiques et de Lettres modernes ainsi qu’au concours spécial de l’agrégation, l’ouvrage propose un complément utile à la réussite du candidat. Comme tous les Autres regards, l’ouvrage est composé de points de vue complémentaires du Clef-concours consacré au même sujet. Lire la suite
- Poèmes dans la rue de Guillaume PeureuxÉditions Hermann, 2022.À la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, de nombreuses personnes ont déposé à proximité des différents lieux de massacres des objets, des images et des textes. Les écrits exposés en ces lieux sont le plus souvent très brefs. Les plus complexes d’entre eux sont des poèmes. On en décompte plus de deux cents. Ces écrits participent à un effort collectif de symbolisation des événements et des sentiments qu’ils ont produits, afin de les fixer pour la mémoire collective ; ils permettent de s’approprier le temps et les événements. Cette irruption de poèmes fugitifs dans l’espace urbain interroge : la poésie n’est pas, pour ainsi dire, à sa place, la rue n’en favorise guère la consommation. Cet ensemble de poèmes produits dans l’urgence des circonstances s’inscrit en fait dans une histoire des formes et des pratiques de l’écriture poétique qui remonte aux siècles classiques et qui s’origine dans les usages les plus anciens de la poésie. Lire la suite
- De main en main de Guillaume PeureuxÉditions Hermann, 2021.Entre la fin du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle, les poèmes appartiennent à ceux qui les lisent : manuscrits ou imprimés, passant de main en main, ils sont objets d’appropriations de formes et d’ampleurs variées, autoritaires, qui entraînent une variabilité insoupçonnée. Celui que l’on désigne comme l’auteur recouvre une réalité plus complexe qu’un nom écrit sur une page de titre. Lire la suite
- Rire des affaires du temps (1560-1653). L’actualité au prisme du rire.Pratiques et formes littéraires 16-18, Cahiers du GADGES N°19, 2022Les différents articles de ce volume étudient comment les écritures comiques permettent de décrire et de commenter l’actualité, voire de la configurer et de la susciter en la publiant. Le rire y apparaît autant comme un instrument susceptible d’offrir un regard critique sur le présent que comme un outil capable de contribuer à hiérarchiser les données du réel et à définir ce que serait l’actuel et ce qui, en tant que tel, devrait intéresser, voire préoccuper les lecteurs. Lire la suite
-
 LA FIGURE DE BOILEAU Représentations, institutions, méthodes (XVIIe-XXIe siècle)Delphine Reguig,Christophe Pradeau (dir), Sorbonne Université Presses, 2020ISBN : 979-10-231-0693-0Date de publication : 08/12/2020Format : 16 x 24 cmNombre de pages : 384 p. Lire la suite
LA FIGURE DE BOILEAU Représentations, institutions, méthodes (XVIIe-XXIe siècle)Delphine Reguig,Christophe Pradeau (dir), Sorbonne Université Presses, 2020ISBN : 979-10-231-0693-0Date de publication : 08/12/2020Format : 16 x 24 cmNombre de pages : 384 p. Lire la suite - Dossiers génétiques de la première modernité de Guillaume Peureux (dir.)Littérales 47, 2020Chacune des contributions du présent numéro de la revue Littérales met en relief les particularités déroutantes des corpus qu’elle traite et montre combien les paramètres de l’édition critique et génétique doivent être ajustés pour décrire et éditer de tels objets, mais également pour rendre compte des faits de genèses textuelles. Lire la suite
- Métamorphoses du commentaire (XVe-XVIIIe siècle) Une anthologieGroupe “Lire, Commenter, Réécrire” Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020Le commentaire tel qu’il est pratiqué dans la première modernité, du Moyen Âge au XVIIIe siècle, ne se limite pas à une exégèse érudite de textes anciens: il peut aussi consister en une réaction à une actualité littéraire ou culturelle. Cette anthologie a pour ambition de faire découvrir au lecteur, par des textes qui, pour certains, n’ont encore jamais été publiés, diverses manifestations de cette écriture en rebond, qui s’invente et s’affirme en même temps qu’elle commente l’oeuvre-source. Comment ces écrits reflètent-ils les débats contemporains dont ils se font l’écho? À quelles intentions, avouées ou cachées, répondent-ils? Quels publics visent-ils? Par quelles stratégies les commentateurs minent-ils l’autorité du modèle d’après lequel ou contre lequel ils construisent leur ethos d’auteur? En s’émancipant des sources dont ils s’inspirent, les textes présentés ici mettent en question les hiérarchies et les valeurs littéraires, ainsi que les mécanismes qui les produisent. Lire la suite
- Paradoxes d’historiens : les enjeux de l’écriture de l’histoire à l’époque des guerres civiles en France (environ 1560-1630) de Mathilde Bernard (dir.)Albineana n°31, 09/12/2019Qu’est-ce qu’un ouvrage historique en premier lieu, mais plus largement, que veut dire « être historien » à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, qui se pense historien ? Cet ouvrage est le lieu de questionnements sur la recomposition des genres historiques, des statuts de l’historien et de la vision que les historiens ont d’eux‑mêmes et donnent à leurs lecteurs. Lire la suite
- Alexandre Hardy, Théâtre complet, Tome IVClassiques Garnier, 2019Le quatrième tome du Théâtre d’Alexandre Hardy, publié en 1626, rassemble trois tragédies (La Mort de Daire, La Mort d’Alexandre, Aristoclée), trois tragi-comédies (Frégonde, Gésippe, Phraarte) et une pastorale (Le Triomphe d’Amour). Le poète y déploie toute la variété de son talent. Lire la suite
- Arts de poésie et traités du vers français (fin XVIE-XVIIE siècles) : Langue, poème, sociétéSous la direction de Nadia Cernogora, Emmanuelle Mortgat-Longuet et Guillaume PeureuxÉditions CLASSIQUES GARNIER, 2019, 15 x 22 cm, 423 p. / Broché, ISBN 978-2-406-06649-1, 52 €Relié, ISBN 978-2-406-06650-7, 89 €. Lire la suite
- Autres regards sur Esther et Athalie de Racine de Guillaume Peureux et Françoise PouletNeuilly, Atlande, 2018.On le voit, les articles réunis dans ce volume ont pour point commun de souligner les multiples clefs de lecture des deux pièces, et notamment la subsumation des problématiques humaines dans le plan théologique, à partir de perspectives qui soulignent les parentés de motifs, de procédés et de structures d’Esther et Athalie (le songe, la révélation, l’avènement du dénouement, etc.), sans pour autant estomper ce qui les différencie. Ces huit études invitent donc les agrégatifs à prêter une vive attention aux textes afin d’en saisir les spécificités et à se familiariser avec une terminologie aussi bien théâtrale que théologique qui leur permettra d’en saisir la nature et les enjeux. Lire la suite
- « Jusqu'au sombre plaisir d'un coeur mélancolique » de Delphine Amstutz, Boris Donné, Guillaume Peureux et Bernard TeyssandierParis, Hermann, 2018.Comment honorer mieux un maître de la critique qu’en suivant les pistes qu’il a ouvertes, en parcourant les territoires qu’il a explorés, en dialoguant avec lui sur les œuvres et les questions qui le requièrent depuis près de quarante ans ? Lire la suite
- François Maynard, Priapées, éd. Guillaume PeureuxClassiques Garrnier, 2018Les cinquante-six poèmes des Priapées de Mainard font résonner la voix obscène du dieu romain des jardins. Achevé avant 1646, ce recueil resté manuscrit témoigne de la persistance d’une poésie libertine après le procès de Théophile de Viau et offre un matériau génétique passionnant. Lire la suite
- Pierre Corneille - Théâtre, tome IIOuvrage publié sous la direction de Liliane Picciola.Éditions CLASSIQUES GARNIER, collection "Bibliothèque du théâtre français ", n°48, 2017, 15 x 22 x 3,7 cm, 1125 p. /59.00 € Lire la suite
- Guillaume Peureux, La Muse satyrique (1600-1622)Genève, Droz, "Les seuils de la modernité", 2014. Lire la suite
- Gilles Ménage, Dissertation sur les sonnets pour la belle matineuseEdition de Guillaume PeureuxParis, Hermann, coll. "Bibliothèque des littératures classiques", 2014 Lire la suite
-

Pierre Eskrich, gravure pour Gabriel Chappuys, Figures de la Bible declarees par stances,
éd. 1582, f° 52, détail (Bnf - Gallica)
Mis à jour le 23 janvier 2026