Version française / RECHERCHES / Equipes du CSLF / Lire Commenter Réécrire (LCR)
Ecritures de l'urgence à l'aube de la modernité
Publié le 26 septembre 2025 – Mis à jour le 27 septembre 2025
Publications CSLF de l'IR Huma-Num, 2025
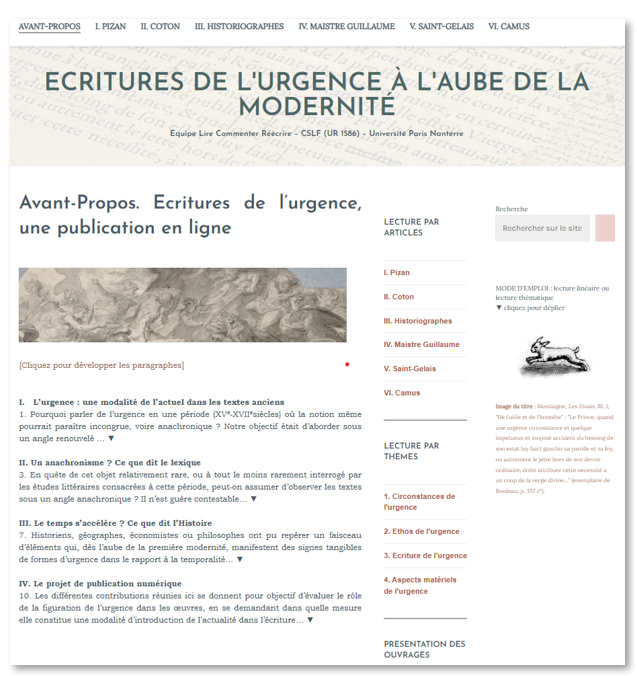
Publication en ligne à double entrée (lecture par articles / par thèmes)
https://cslf.huma-num.fr/ecrituresdelurgence/
https://cslf.huma-num.fr/ecrituresdelurgence/
- Pourquoi parler de l’urgence en une période (XVe‑XVIIe siècles) où la notion même pourrait paraître incongrue, voire anachronique ? Notre objectif était d’aborder sous un angle renouvelé une réflexion de plus longue haleine, menée depuis 2016 au sein du groupe « Lire, Commenter, Réécrire » du CSLF (Centre des Sciences des Littératures en langue Française, Université Paris‑Nanterre), autour de la question de la prise en compte du présent, et plus spécifiquement de l’actualité, dans les écrits en français des siècles anciens. Après un travail commun consacré aux commentaires exprimant des réactions « à chaud » vis‑à‑vis d’œuvres contemporaines, il s’agissait d’explorer les manifestations de la pression exercée par les faits contemporains sur les écrits, et d’interroger la manière dont ces derniers reflètent une telle contrainte ou la mettent en scène. Avec l’urgence, la relation à l’actualité se double d’une représentation plus subjective du temps impliquant une sensibilité aux rythmes et à la perception des effets de la temporalité. Comment la formulation d’un sentiment d’urgence contribue‑t‑elle à ancrer des modalités d’expression du présent dans l’écriture, quand la période même à laquelle les écrits appartiennent est réputée avoir pour horizon de référence le passé, au premier chef le passé antique ? Et comment ces modalités de représentation du présent agissent‑elles sur la légitimité et l’efficacité de l’œuvre ?
- Au fil de ce travail d’équipe et des rencontres scientifiques qu’il a suscitées, des axes d’analyse dominants se sont dessinés. Notre propos sera guidé par trois d’entre eux : chaque contribution abordera en effet la question des circonstances de l’urgence et des stratégies qu’elle suscite (1), envisagera les enjeux qu’elle pose par rapport à la constitution de l’ethos du locuteur ou de la locutrice, de l’auteur ou de l’autrice (2), et s’interrogera enfin sur les manifestations tangibles d’une écriture de l’urgence (3). Chaque contributrice, chaque contributeur a rédigé son analyse en suivant ces trois pistes dans cet ordre, afin de favoriser la comparaison entre les phénomènes observés dans les différents contextes envisagés. En outre, cette structuration commune crée la possibilité d’une lecture modulaire, procédant par axes plutôt que par corpus.
- Le format numérique adopté permet de lire de manière groupée, et accompagnées d’une section introductive, toutes les sous-parties évoquant les circonstances, celles qui analysent l’ethos, ou celles qui traitent des modalités d’écriture. Une quatrième question, touchant à la manière dont l’urgence peut affecter la matérialité de l’œuvre, ou être traduite par elle, a été traitée sur un mode plus transversal. Cette présentation quelque peu singulière a pour ambition d’expérimenter et d’exploiter au mieux les possibilités offertes par l’édition numérique, afin qu’elle ne constitue pas une simple transposition en ligne d’une édition sur papier.
Mis à jour le 27 septembre 2025












